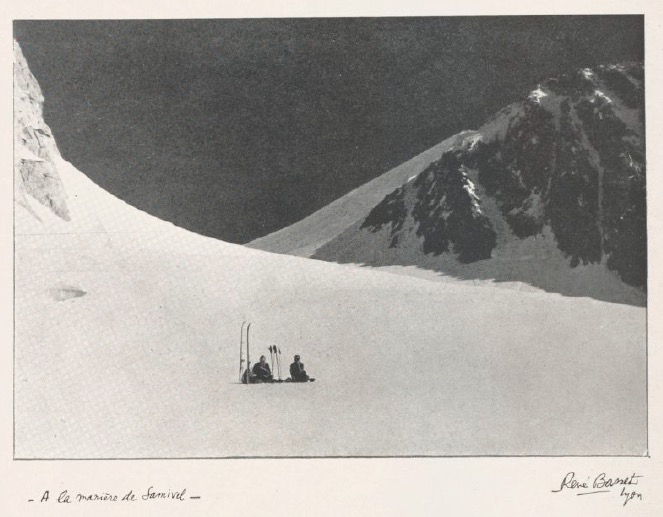En pénétrant, Alain et moi, sur le quai de la gare de Chamonix, nous fûmes émerveillés : le soleil, jouant comme avec un réseau sur le fin solénoïde noyé dans les tubes en plastec transparent où se mouvaient les cars magnétiques, y faisait naître des myriades de petits arcs-en-ciel du plus ravissant effet.
De minute en minute, les cars avalaient ou dégorgeaient des cargaisons de touristes.
Nous prîmes place dans un des cars de luxe réservés aux alpinistes d’élite et attendîmes le départ.
*
* *
En somme nous avions de la chance. Nos demandes de saison alpine, rédigées en 10 exemplaires, avaient été agréées en haut lieu, ce qui arrivait rarement à la première tentative. Le Strato-réactobus nous avait amenés de Paris en 25 minutes à peine (il avait, il est vrai, 7 heures de retard dues à une grève). Dès notre arrivée, nous nous étions soumis aux cribles administratifs. Le Grand Censeur Knife, célèbre par son décret sur la répression du rire en montagne, nous avait fait subir un interrogatoire serré pour vérifier l’orthodoxie de nos conceptions sur l’alpinisme. Les inhibiteurs de vieillissement l’avaient maintenu tel qu’il était il y a 35 ans, sec et filiforme ; il avait, bien entendu, déclaré que nous ne savions pas poser les problèmes, mais il n’avait pu nous prendre en défaut car nous connaissions parfaitement notre théorie. Cela avait accroché seulement lorsque nous avions émis la prétention de faire la directe de la face ouest du Dru ou l’arête nord du Caïman :
« Comment, avec une licence de 6, vous en avez du toupet ! Vous irez à la Walker, comme tout le monde. »
*
* *
Nous nous étions connus, Alain et moi, en tirant, comme tous les ressortissants de la Section française de la Sous-Communauté européenne, nos trois ans de service éducatif par la montagne. Nous aurions désiré le faire à Fontainebleau, mais ce centre avait été détruit à la 3e guerre mondiale ; une petite bombe superatomique, larguée par erreur, y avait explosé, avait carbonisé la forêt, fondu et vitrifié les rochers ; on l’utilisait à présent, en raison de son absolue planéité, comme autodrome de course. Alain et moi, avions été affectés à l’alpinodrome de Montreuil ; il était techniquement bien supérieur à Fontainebleau, mais trop éloigné, à notre goût, du Centre féminin de Beauce. Nous étions sortis dans la botte avec le diplôme d’Aspirant-Alpiniste d’élite (A. A. E.) et nous avions même décroché l’un et l’autre un accessit au Concours Général de l’Académie des Sciences Morales et Alpinistiques. Ce qui nous avait valu le nombre suffisant de points pour postuler au Club Alpin Terrestre.
À vrai dire, nous avions été servis par un bon atavisme et par le souvenir que gardait le Grand-Maître Slogan de mon grand-père. Et pourtant le pauvre homme, était-il arriéré ! Me faisant sauter, tout petit, un jour, sur ses genoux, il me confia qu’il pratiquait autrefois l’alpinisme uniquement pour le plaisir. Ma mère, surprenant ce propos indécent, l’avait vertement rabroué et avait rappelé au vieillard que l’alpinisme était un Devoir et non une frivolité. Je ne lui en avais pas tenu rigueur et j’écoutais, comme des contes de Fées, ses propos d’un autre âge. Le pauvre vieux racontait que le Club Alpin, autrefois, servait uniquement à réunir dans de bons fauteuils de vieux copains qui bavardaient, à perte de vue, de courses sans intérêt et de projets enfantins, comme le Grépon Mer de Glace ou la Meije directe.
Tout cela avait heureusement changé, grâce au triomphe de l’Éducation morale par l’alpinisme qui avait porté le Progrès social à la perfection et, depuis la conquête de Mars et de Vénus, l’alpinisme à la classe interplanétaire. Les Clubs s’étaient unis en Club Alpin Terrestre, dont le Grand-Conseil gouvernait de droit la Planète et ses dépendances. Il était élu à 7 degrés au scrutin secret, par bulletins signés. Seuls les candidats présentés par le Comité étaient éligibles ; ils recueillaient ainsi souvent des unanimités de plus de 100 %. Le roulement des membres du Conseil était assuré par les prénoms ; c’est ainsi qu’à Luc-André Slogan succédait André-Luc Slogan. Les membres du Comité de Rédaction du « Bleausard en Montagne », revue officielle du C. A. T., formaient la nouvelle Académie Française ; ils avaient élevé la littérature alpine à un tel degré de tenue que les écoliers actuels la dévoraient avec autant d’enthousiasme que Fénelon les jeunes de 1948. Bref l’Éducation morale par la montagne avait apporté la félicité sur Terre.
*
* *
De la fenêtre du car, en effet, nous apercevions les barbelés du camp de relégation ; des criminels qui avaient tenu des propos subversifs, d’autres qui s’étaient engagés en haute montagne sans les formalités réglementaires, d’autres enfin impardonnables qui avaient tenté de se soustraire à l’éducation morale, bref les inassimilables, y grimaçaient.
Vers les Pélerins montait, nostalgique, la fumée du Crématorium où les Secours en Montagne incinéraient les victimes innombrables de leur mauvaise éducation alpine. Un clair appel de trompette tinta à la proche caserne d’instruction alpine. Il coïncida avec le départ de notre car.
Nous prîmes progressivement notre vitesse dans les anneaux hélicoïdaux du tube de plastec du Couvercle. Les artistiques panneaux réclames qui bordaient la voie tous les 10 mètres nous fournirent un thème de conversation et nous discutâmes, Alain et moi, des mérites comparés des semelles en silicone adhésive (marque la Lune) ou magnétique (marque le Soleil), de la légèreté des combinaisons d’escalade en super-nylon soufflé ou atomisé (200 grammes au total), de la sécurité des attaches magnétiques ou par doubles liaisons éthyléniques (qui avaient détrôné les anciennes cordes en nylon). Uns chute de pierres, sous la Charpoua, attira un moment notre attention, mais c’était pour le tube de plastec une épreuve dont il se jouait. D’ailleurs nous arrivions au Couvercle.
*
* *
En descendant du car, nous fûmes assaillis par une horde qui, aux cris de « porteur, porteur », voulut se saisir de nos sacs. Mais, trop démunis pécuniairement, nous résistâmes à leurs invites.
La place du Couvercle, bordée de magasins et d’hôtels, était extraordinairement animée. Les touristes, personnes âgées n’ayant pu bénéficier de l’Éducation morale, s’engouffraient en foule dans le pédoncule de la Tour d’Observation, en forme de gigantesque tulipe, dont la tête dominait la Verte de 300 mètres.
L’arête sud du Moine était crénelée par les élèves de la Caserne du Couvercle. Les coups de gueule des adjudants nous parvenaient à travers le brouhaha de la foule : parfois on entendait le cri d’angoisse d’un élève qui dérochait. Les équipes de secours dirigeaient le corps immédiatement au Crématorium. Nous avions enfin terminé cette dure période de notre vie ; nous volions maintenant de nos propres ailes ; à nous le 6 et la liberté, en attendant peut-être le 6p et le 6q qui nous ouvriraient les portes du groupe des alpinistes d’élite, (A. E.).
Le car circulaire nous déposa en quelques minutes sur le glacier de Leschaux. Nous montâmes à pied au bas de l’éperon Walker, distraits un moment par le bulldozer du cantonnier qui déblayait les moraines afin que la Mer de Glace fut immaculée au Montenvers.
Allongé dans un transatlantique, devant sa baraque, le chronométreur nous accueillit, placide, fumant sa pipe. Il vérifia nos papiers, nous donna notre fiche de course qui portait le n° 17.508 et nous donna le départ.
Il était de très bonne heure, 14 h 35. Nous avions donc du temps devant nous. Suivant les flèches, j’attaquai. Nos semelles de silicone faisaient merveille. Solidement arrimé par mon piton-ventouse à vide moléculaire, je déclenchais le contact de ma pile à neutrons et Alain, enlevé, allait se fixer 6 à 8 mètres au-dessus de moi. Les longueurs paramagnétiques succédaient aux longueurs paramagnétiques. Notre progression un peu monotone fut un moment stoppée par un raide couloir de glace. Je sortis mon piolet-cautère à bikinium, et dans un grésillement de caléfaction, modelai les marches nécessaires pour atteindre à nouveau le rocher. Pendant ce temps Alain m’assurait de la pique rougie de son piolet, enfoncée jusqu’à la garde dans la glace. Et l’escalade reprit.
Un coup de sifflet nous arrêta ; c’était un garde, qui dans le léger ronflement de son hélicoptère dorsal vint se poser sur une plate-forme près de nous et demanda nos papiers. En dépit de la mitraillette à électrons qu’il portait en bandoulière, il était apparemment de bonne humeur et nous libéra en disant : « Vous, au moins, vous êtes réguliers ; c’est pas comme ces trois que j’ai dû descendre hier à la face nord des Grands Charmoz, parce qu’ils se servaient d’un fusil à pitons de métal. On aura tout vu ! »
Nous poursuivîmes ; peu après nous fûmes distraits par une cordée féminine engagée à notre niveau, dans le facile éperon central. Nous échangeâmes au télélaryngophone quelques agaceries de circonstance. Mis en gaîté nous nous accordâmes quelque repos et, engourdis par la chaleur de nos combinaisons, nous nous endormîmes.
Au réveil, il faisait nuit. Catastrophe ! Alain rugit : « Eh bien mon vieux, on est bon pour la rampe ». Effectivement, la rampe à lumière de
Wood de Leschaux se déclencha et illumina la substance luminescente qui enduisait notre route.
« Cela va nous coûter cher, ce coup de rampe, je doute qu’il nous reste assez d’argent pour faire une autre course ».
Un malheur ne vient jamais seul ; un grondement lointain retentit. « L’orage, il ne manquait plus que cela ». En effet, 1/4 d’heure plus tard de gros nuages sombres se déversaient sur l’arête, venant d’Italie. Les premiers flocons de grésil tombaient, quand l’air se mit à vibrer ; les nuages s’arrêtèrent de déferler, et comme effrayés, reculèrent et se dissipèrent. Leschaux venait de mettre en route son antimétéore à infra-rouge. « Ce coup-ci, mon vieux, dis-je à Alain, non seulement notre saison est fichue, mais il faudra faire un appel au peuple pour régler les frais ».
Peu de temps après nous parvenions à l’arête et nous pénétrions dans le hall de l’hôtel Belvédère ; sur tous les sommets importants, en effet, avaient été construits par Gachère, le Grand Architecte, des hôtels belvédère spacieux et confortables, parfaitement harmonisés avec le paysage. Contrairement à nos craintes, le chronométreur n’était pas de mauvaise humeur de nous avoir attendu, car il était encore en conversation avec la cordée féminine du Whymper.
« Alors, jeunes gens, on manque encore d’expérience ? Vous allez me signer les notes de rampe de Wood et de Radar antimétéore. Et puis je me vois dans l’obligation de faire mon rapport au Grand Censeur. Il est déjà 23 heures 45, vous avez dépassé les limites de près de 5 heures. »
Les jeunes filles gloussèrent, en se poussant le coude ; mortifiés, nous nous retirâmes dans nos chambres.
« En bien, me dit Alain, nous avons gagné ; non seulement nous voilà fauchés pour un bout de temps, mais pour notre accession à la licence supérieure et au titre d’alpiniste d’élite, adieu veau, vache, cochons, couvée, nous ne sommes pas près d’y parvenir. »
Hélas oui. Je me demande si après tout mon grand-père n’avait pas raison. Je me rappelle avoir lu dans sa bibliothèque, dans un livre interdit d’un certain La Fontaine, une fable intitulée : « Les grenouilles qui demandent un roi », je me demande si, quand on a adopté l’Éducation morale par la montagne nous n’avons pas joué les grenouilles ? ».
Le visage d’Alain se ferma…
Depuis cette soirée, j’ai l’impression que Alain m’évite, comme s’il avait peur de se compromettre.
***
Marcel Renaudie, Une course en 1998, in La Montagne, revue mensuelle du Club alpin français, n° 333, juillet-août 1946
Ce texte n’est pas libre de droit. Il est publié à titre de respectueux hommage pour Marcel Renaudie (1903-1979). Il reste tous droits réservés. Si vous êtes ayant-droit et que vous vous opposez à la publication, merci de nous contacter.