
Tous les dimanches, dans les colonnes d’ArchéoSF, le fameux journaliste Jean Lecoq prend la plume dans la rubrique L’œil de Lecoq !

Au mois de mars dernier, la Société Royale de géographie d’Angleterre et le Club alpin de Londres décidèrent d’organiser une expédition dans le but d’atteindre la cime la plus élevée de l’univers.
Ce point culminant du monde se trouve, comme chacun sait, dans la chaîne de l’Himalaya. On l’appelait autrefois le Gaurisankar ; les Anglais l’ont débaptisé et lui ont donné le nom de Mont Everest, en souvenir de l’ingénieur qui, le premier, en 1856, détermina son altitude probable.
Cette altitude n’est d’ailleurs pas fixée très exactement : les évaluations flottent de 8.750 à 8.840 mètres. Mais qu’est-ce qu’une centaine de mètres ?… Ce qu’il y a de certain c’est que l’Everest est presque double en hauteur de notre géant d’Europe, le Mont Blanc, et cette simple comparaison vous donne déjà une idée des difficultés que rencontrera l’entreprise.
 Jusqu’à la fin du XIXe siècle, ce toit du monde n’avait pour ainsi dire pas encore tenté les explorateurs. Le célèbre alpiniste anglais Mummery fut un des premiers qui s’y essayèrent.
Jusqu’à la fin du XIXe siècle, ce toit du monde n’avait pour ainsi dire pas encore tenté les explorateurs. Le célèbre alpiniste anglais Mummery fut un des premiers qui s’y essayèrent.
Cet avait la passion des escalades. Jamais l’humanité ne vit pareil grimpeur. À l’âge de quinze ans, il était monté déjà au sommet du Cervin. Pendant des années, il se fit le compagnon volontaire d’un des guides les plus expérimentés du Valais. Le Mont Blanc n’avait plus aucun secret pour lui ; il l’avait gravi sur toutes ses faces, même les plus abruptes. Puis, il était parti au Caucase chercher des émotions nouvelles.
Enfin, il avait résolu de s’attaquer aux plus hautes cimes du monde. En 1895, à la tête d’une petite expédition, composée de quelques alpinistes non moins intrépides que lui-même, il entreprenait l’ascension du Nanga-Parbat, un des plus hauts sommets (8.200 mètres) de l’Himalaya.
Quinze jours après le départ, la petite troupe, au prix de difficultés sans nombre, avait atteint l’altitude de 6.000 mètres. On campait dans la neige, avec une température de vingt-cinq degrés de froid. Mummery était parti seul, un matin, afin d’explorer la montagne et de préparer la route. Il ne revient pas, et son corps ne fut pas retrouvé. Un pont de neige avait-il cédé sous son poids et une crevasse l’avait-elle englouti ?… On n’en sut jamais rien. La montagne avait enseveli dans son linceul mystérieux celui qui, tant de fois, avait bravé ses dangers.
Avant Mummery, William Graham, en 1883, avait monté à 7.300 mètres sur le Kaloru, et, en 1892, l’expédition Conway-Eckenstein avait atteint, dans l’Himalaya occidental, le Pic des Pionniers, à l’altitude de 7.000 mètres. Dix ans plus tard, en 1902, les mêmes explorateurs, accompagnés de deux alpinistes autrichiens et du docteur suisse Jacot-Guillarmod, tentaient dans la même région, l’assaut du Chogori. L’expédition était considérable : il avait fallu pour transporter les provisions à travers l’immense glacier de Balstore, engager 250 coolies.
 Les explorateurs, arrêtés à 6.400 mètres par les intempéries, établirent un camp où ils durent demeurer de longs jours. C’est là certainement le point le plus élevé de la terre où des hommes séjournèrent pendant des semaines.
Les explorateurs, arrêtés à 6.400 mètres par les intempéries, établirent un camp où ils durent demeurer de longs jours. C’est là certainement le point le plus élevé de la terre où des hommes séjournèrent pendant des semaines.
Mais les bourrasques étaient si violentes, le froid tellement intolérable, que l’expédition dut battre en retraite. Les explorateurs revinrent amaigris, épuisés, sans avoir pu atteindre le but qu’ils s’étaient fixés.
L’année suivante, sur la face ouest du même mont Chogori, M. et Mme Bullock-Workman parvenaient à une hauteur de plus de 7.000 mètres.
Vers l’altitude des 6.000 mètres, Mme Bullock-Workman avait effroyablement souffert du mal des montagnes. Elle n’en continua pas moins l’ascension. Admirable exemple d’énergie, d’endurance et de fidélité conjugale !
En dépit dues exigences du Code, combien de femmes consentiraient à suivre leur mari à de telles hauteurs ?…
En 1905, nouvel échec d’une expédition tentée par le docteur Jacot-Guillarmod et quelques explorateurs anglais et suisses pour atteindre le sommet du Kinchinjinga (8.845 mètres). L’un des alpinistes fut enlevé par une avalanche ; les survivants durent abandonner la partie.
La même année, l’expédition du docteur Longstaff, au mont Curla Mandhata (7.760 mètres), n’eut pas plus de succès. Elle aussi faillit être victime d’une avalanche. Après avoir campé pendant une semaine à 6.600 mètres d’altitude, il fallut renoncer à poursuivre l’aventure.
Mais le docteur Longstaff devrait prendre sa revanche quelques années plus tard, en atteignant le sommet du Trisul (7.115 mètres). C’est jusqu’à présent, dans l’Himalaya, la montagne la plus élevée dont la pointe extrême ait été foulée par un pied humain.
Ce n’est d’ailleurs pas le record de l’altitude atteinte. Ce record appartient au duc des Abruzzes qui, en 1909, monta à 7.422 mètres sur le Karakoroum.
Telles sont, jusqu’à présent, les principales étapes de l’ascension dans la grande chaîne indo-thibétaine — étapes bien modestes si l’on considère qu’à part le Trisul, aucun pic de l’Himalaya n’a été atteint jusqu’à ce jour, et qu’on n’a pas même tenté encore l’ascension des plus hautes montagnes, telle le Danlaghiri qui a 8.200 mètres, le Makalu qui en a 8.600 et l’Everest qui dépasse apparemment 8.800.
Car l’expédition anglaise, qui a pour but la conquête du plus haut pic du monde n’en est encore qu’à l’exploration des abords de la montagne. On n’attaque pas sans précautions un géant tel que l’Everest.
Cette « great adventure », comme disent les Anglais, doit se faire, d’ailleurs, en deux étapes. Au mois de mai dernier, une première mission, sous la direction du colonel Howard-Bury, s’est réunie à Dardjiling, la dernière ville anglaise, située sur les contreforts de l’Himalaya, à 2.000 mètres d’altitude. De là, les explorateurs ont gagné le versant thibétain de l’Everest.
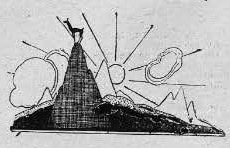 Car c’est par le Thibet que l’ascension doit s’effectuer ; et le fait vaut qu’on le remarque. On sait, en effet, que jusqu’à présent les frontières de ce pays avaient été fermées aux étrangers. Or, les documents fournis par la téléphotographie ont démontré que du côté du Nepaul, c’est-à-dire sur le versant sud, le mont Everest est extrêmement abrupt ; l’ascension en serait probablement impossible. Par contre, au nord, du côté thibétain, la montagne semble s’élever en pentes douces. Et c’est également l’opinion du colonel anglais Dudley-Rider, le seul Européen qui a pu, jusqu’à présent, voir d’assez près le géant de l’Himalaya.
Car c’est par le Thibet que l’ascension doit s’effectuer ; et le fait vaut qu’on le remarque. On sait, en effet, que jusqu’à présent les frontières de ce pays avaient été fermées aux étrangers. Or, les documents fournis par la téléphotographie ont démontré que du côté du Nepaul, c’est-à-dire sur le versant sud, le mont Everest est extrêmement abrupt ; l’ascension en serait probablement impossible. Par contre, au nord, du côté thibétain, la montagne semble s’élever en pentes douces. Et c’est également l’opinion du colonel anglais Dudley-Rider, le seul Européen qui a pu, jusqu’à présent, voir d’assez près le géant de l’Himalaya.
Il allait donc obtenir du gouvernement thibétain l’autorisation pour la mission de l’Everest de franchir la frontière et d’explorer la région qui s’étend au pied du mont. La diplomatie anglaise s’y est employée avec son habileté ordinaire, et ses efforts ont été couronnés de succès. Non seulement le gouvernement thibétain a donné aux alpinistes anglais l’autorisation de pénétrer sur son territoire, mais il leur a promis son concours entier pour la réussite de l’entreprise.
La mission Howard-Bury est donc partie depuis quatre mois pour explorer les abords de la plus haute montagne du monde. Elle vient de donner pour la première fois de ses nouvelles.
Les explorateurs parcourent, depuis le départ, la masse formidable de montagnes au centre de laquelle se dresse le pic gigantesque de l’Everest. Ils cherchent le chemin le plus commode pour parvenir jusqu’au géant qui se trouve encore à cinquante milles de là, dans la direction du sud. Mais cette route, le colonel Howard-Bury, dans la lettre qu’il vient d’envoyer à Calcutta, déclare qu’il ne l’a pas encore découverte.
Le 16 juillet dernier, après avoir séjourné dans un monastère thibétain où vivent quatre cents moines et religieuses, la mission se trouvait à une altitude d’environ 6.000 mètres. Elle a rencontré là une quantité considérable de moutons et d’oiseaux qui, n’ayant jamais été traqués ni chassés, vivent en confiance avec l’homme. Les uns viennent prendre la nourriture qu’on leur offre dans la main, les autres se posent familièrement sur l’épaule des voyageurs.
Cette vision du Paradis terrestre a ravi le colonel Howard-Bury et ses compagnons, mais ne les a pas arrêtés. Ils ont repris leur alpenstock et sont repartis à la recherche de la route mystérieuse. Dès qu’ils l’auront découverte, dès qu’il auront étudié complètement la géographie de la région, relevé les conditions météorologiques, préparé les gites d’étapes, la première partie de l’entreprise sera accomplie.
Ils reviendront alors à Dardjiling, d’où, munie de tous les renseignements qu’ils auront recueillis, partira la seconde mission, celle des ascensionnistes, qui devront atteindre au sommet du plus haut pic du monde.
Ce sera pour la belle saison de 1922.
Les organisateurs de l’entreprise n’en évaluent pas le coût total à plus de cinq cent mille francs. Si le triomphe est au bout, il faut avouer que ce ne sera pas payer trop cher pareille conquête que de la payer d’un demi-million.
Mais, diront les sceptiques, les sédentaires, les ennemis de la grande activité sportive : à quoi bon ?… Quel profit l’humanité retirera-t-elle de cette conquête ? Et n’est-ce point folie de la part de ces hommes de s’imposer tant de fatigues, tant de souffrances, de risquer la mort, même pour l’unique gloire d’avoir atteint un point du globe réputé jusqu’alors inaccessible ?
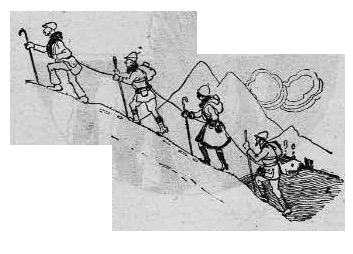 À quoi bon ?… Mais outre les précieux enseignements que la science retirera de l’exploration de ces contrées mystérieuses, ne faut-il point admirer sans réserve l’énergie qui pousse ces explorateurs à la plus aventureuse des entreprises ? Les hommes d’aujourd’hui éprouvent un sentiment que nos ancêtres ont ignoré. Ils sont attirés par ces sommets que nos pères ne considéraient qu’avec terreur, voire même avec horreur.
À quoi bon ?… Mais outre les précieux enseignements que la science retirera de l’exploration de ces contrées mystérieuses, ne faut-il point admirer sans réserve l’énergie qui pousse ces explorateurs à la plus aventureuse des entreprises ? Les hommes d’aujourd’hui éprouvent un sentiment que nos ancêtres ont ignoré. Ils sont attirés par ces sommets que nos pères ne considéraient qu’avec terreur, voire même avec horreur.
À ceux qui ont gardé ce lointain préjugé, à ceux qui disent « à quoi bon ? » quand on leur parle des exploits de l’alpinisme, Mummery, la glorieuse victime du Nanga Parbat, a répondu naguère dans des pages magistrales sur les vertus de la montagne.
« Elle enseigne à ses fidèles, dit-il, le courage, l’endurance et la confiance mutuelle ; elle les force à regarder la mort en face… Qu’il réussisse ou qu’il échoue, l’alpiniste trouve sa jouissance dans la lutte… Les sentiments qu’il éprouve alors font circuler le sang dans les veines ; ils abolissent le pessimisme ; ils rendent heureux… »
» On peut admettre, conclut-il, que la montagne apporte quelquefois à ses fidèles une vision un peu trop claire de l’imminence de la mort. Mais si farouches et désespérantes que puissent parfois paraître les grandes murailles de roc et de glace, on a toujours le sentiment que de braves compagnons et un courage sans défaillance seront suffisants pour déchirer la toile croissante du danger… »
Énergie, mutuelle confiance, mépris du danger, ce sont les vertus que la montagne enseigne aux hommes. Admirons, envions ceux qui les pratiquent, ceux qui ne redoutent pas « la vision trop claire de l’imminence de la mort », et souhaitons, quand ils se lancent dans les entreprises comme celle de l’Everest, que les vœux de l’humanité les accompagnent.
—
Jean LECOQ — Le Petit journal illustré du 11 septembre 1921
Photographie : Expédition Everest de Charles Howard-Bury en 1921
